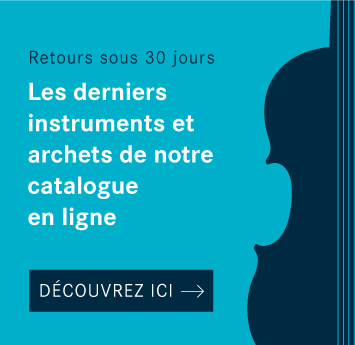La Chaconne de la Partita n° 2 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach est considérée comme l'une des compositions les plus impressionnantes de la littérature pour violon. De nombreux interprètes et chercheurs y voient plus qu'un simple chef-d'œuvre technique et interprètent cette pièce comme l'expression musicale d'un deuil personnel. Probablement composée à la mémoire de la première épouse de Bach, la chaconne allie profondeur émotionnelle et rigueur de la composition. Son impact repose sur une intensité silencieuse qui perdure encore aujourd'hui et sa résolution pose de grandes questions aux musiciens et aux musicologues.
Chaconne de Bach : aperçu
1. La chaconne - structure, symbolisme des nombres et intertextualité
2. Contexte de la chaconne dans la vie et l'œuvre de J. S. Bach
3. Arrangements et transcriptions de la Chaconne
4. Interprètes importants de la Chaconne
5. Partitions: Éditions importantes de la Chaconne
6. Le bon violon pour la chaconne - choix de l'instrument dans le contexte historique et moderne
1. La chaconne - structure, symbolisme des nombres et intertextualité
La structure de la Chaconne de Bach
La Chaconne de Bach est une œuvre monumentale de 256 mesures - plus que les quatre mouvements précédents de la Partita no 2 en ré mineur (BWV 1004) réunis, qui constituent son contexte immédiat. Elle est basée sur la forme de l'ostinato, dont une basse récurrente constitue le fondement. Bach se réfère ici à la tradition italienne, dans laquelle le thème est souvent figuré et semble difficilement reconnaissable. Dans la chaconne, le motif de la basse alterne entre une basse lamento (ré-c-b-a) et un passus duriusculus.
Symbolique des nombres et références intertextuelles dans la Chaconne de Johann Sebastian Bach
La complexité de la chaconne se reflète dans une multitude d'analyses scientifiques, parmi lesquelles les structures à interpréter sont souvent déjà controversées. Ainsi, certaines analyses partent d'une structure en 64 variations de quatre mesures, tandis que d'autres divisent la chaconne en 34 variations, dans lesquelles on trouve 8 fois les quatre premières mesures et 26 fois les huit mesures. La structure en trois parties, une première partie mineure avec 33 variations, une partie centrale majeure avec 19 variations et une partie finale mineure avec 12 variations, entraîne une augmentation dramatique grâce au raccourcissement des variations par section: la musique devient plus intense, plus dense, les cadences commencent plus tôt. De plus, les passages diatoniques et chromatiques, les tonalités mineures et majeures, les ruptures d'accords et les passages d'échelle contrastent. La polyphonie, souvent à peine esquissée, est suggérée par une conduite habile de la voix, comme c'est le cas, sous une forme similaire, dans les célèbres suites pour violoncelle de Bach (voir ci-dessous, chap. 2).
Sur la base de ces observations structurelles, la musicologie explore l'architecture sonore de la chaconne non seulement d'un point de vue musical, mais aussi en termes de symboles numériques; de nombreux auteurs interprètent la division en trois sections (mineur-majeur-mineur) comme un récit spirituel ou biographique. Heinrich Poos, par exemple, voit dans le chiffre 4 une allégorie des quatre éléments ou des quatre saisons (musica mundana), des quatre âges de la vie (musica humana) et des quatre cordes du violon (musica instrumentalis). D'autres chercheurs analysent des structures symétriques et supposent derrière le nombre 30 - le nombre de variations avant et après la partie majeure - un calcul compositionnel conscient que l'on retrouve également dans d'autres œuvres comme les Variations Goldberg.
Helga Thoene va particulièrement loin dans son analyse. Dans son livre «Ciaccona - Tanz oder Tombeau?» elle argumente que Bach a composé avec la Chaconne un monument funéraire pour sa femme décédée. Elle identifie des chœurs cachés, basés sur la conversion des notes en chiffres (gématrie), et découvre des références à l'année liturgique dans la composition. Judith Bernhardt argumente de la même manière en identifiant les noms de la famille Bach dans la partition à l'aide d'un alphabet numérique. Des critiques comme Martin Geck considèrent ces thèses comme spéculatives, mais soulignent que la symbolique des nombres jouait un rôle important à l'époque baroque. Geck met également en garde contre le recours à des éditions imprimées, car seuls les autographes reflètent de manière authentique le processus de composition.
2. Contexte de la chaconne dans la vie et l'œuvre de J. S. Bach
La chaconne est le dernier mouvement de la Partita n° 2 en ré mineur (BWV 1004), l'une des six œuvres du cycle «Sei Solo. a Violino senza Basso accompagnato» (BWV 1001-1006). Ce cycle a été composé à Köthen en 1720, d'après la mise au net, les débuts remontant peut-être à l'époque de Weimar (1708-1717). Bach trouvait à Köthen des conditions idéales: Le prince Leopold d'Anhalt-Köthen était très mélomane, l'orchestre de la cour était excellent et la musique instrumentale était particulièrement encouragée.
La Chaconne de Bach en tant qu'œuvre polyphonique pour soliste
La «Sei Solo» et les suites pour violoncelle (BWV 1007-1012) démontrent la profonde familiarité de Bach avec la technique de jeu des instruments respectifs. Malgré l'absence de basse continue, il parvient à créer une polyphonie dense et une harmonie complexe. La mélodie solo en accords, l'unisson pur et la polyphonie riche en suggestions se combinent de manière unique.
La chaconne occupe une place à part, tant du point de vue de la virtuosité que de l'expression. Sa rigueur formelle et sa profondeur émotionnelle en font une œuvre clé dans l'œuvre de Bach et un sommet de la littérature pour violon seul.
3. Arrangements et transcriptions de la chaconne
Arrangements de la Chaconne de Jean-Sébastien Bach au 19e siècle
La Chaconne de Jean-Sébastien Bach a fait l'objet de nombreuses adaptations et transcriptions au fil du temps. Dès le milieu du 19e siècle, des musiciens ont commencé à adapter l'œuvre à d'autres formations. Des personnalités comme Felix Mendelssohn Bartholdy et Robert Schumann estimaient qu'il était incompréhensible que Bach ait écrit cette partita sans aucun accompagnement. Mendelssohn publia un accompagnement pour piano en 1847, Schumann suivit en 1853. L'arrangement du violoniste August Wilhelmj de 1885 est particulièrement remarquable, il ajouta même une version orchestrale.
Les transcriptions pour piano, qui ont débuté dans les années 1850, ont atteint leur apogée en 1893 avec l'arrangement de Ferruccio Busoni. Celle-ci est tellement originale qu'elle est souvent considérée comme une œuvre à part entière. Johannes Brahms a également contribué à la diversité des transcriptions - avec une version pour la main gauche seule. En outre, des versions pour orgue, orchestre à cordes, quatuor à cordes, flûte, guitare, harpe et de nombreux autres instruments ont été créées.
Profondeur religieuse : la version de Helga Thoene de la Chaconne de Jean-Sébastien Bach
L'analyse de Helga Thoene, discutée au chapitre 1, fait également l'objet d'une interprétation musicale: Thoene a accompagné l'œuvre des citations de choral qu'elle a identifiées et qui, selon elle, fonctionnent comme un cantus firmus musical. En collaboration avec le violoniste Christoph Poppen et le Hillard-Ensemble, elle a enregistré un CD dans lequel le chœur et les mouvements de la partita sont entremêlés. Cet enregistrement représente une forme particulière de réception qui souligne la profondeur religieuse et émotionnelle de l'œuvre.
4. Interprètes importants de la chaconne
La Chaconne a été et est toujours interprétée par les plus grands violonistes de l'histoire de la musique. Dans sa forme originale pour violon seul, elle a été enregistrée par Jascha Heifetz, Yehudi Menuhin et Gidon Kremer. L'interprétation de Heifetz de 1952 est basée sur la partition de son professeur Leopold Auer, dont la manière de jouer romantique - incluant portamento et spiccato - n'est pas sans controverse.
Joseph Szigeti, un petit-fils de Joseph Joachim, enregistra en 1956 une version qui combinait la perspective historiquement informée de Joachim avec une interprétation romantique. Arthur Grumiaux a apporté une clarté polyphonique à son enregistrement en 1961, tandis que Christian Tetzlaff a combiné en 1995 un style de jeu d'inspiration baroque avec une technique moderne - avec un tempo rapide, un vibrato et des ornements parcimonieux.
La Chaconne de J. S. Bach dans la pratique d'exécution historique
Des interprétations historiquement informées sur des violons baroques, comme celles de Sigiswald Kuijken (1981) ou de Rachel Podger (1997/1999), éclairent l'œuvre d'un jour nouveau. C'est avec une interprétation particulièrement inhabituelle que Joshua Bell s'est assuré une place dans l'histoire de l'interprétation de la chaconne, en la jouant en 2008 comme musicien de rue dans une station de métro de Washington.
Yehudi Menuhin voyait dans la Chaconne l'œuvre la plus importante pour violon solo. La pianiste Hélène Grimaud la décrit comme «une danse de vie et de mort» - une œuvre à l'architecture de cathédrale, dont les variations ressemblent à des lumières colorées à travers des vitraux.
5. Notes: Principales éditions de la Chaconne
La Chaconne a été publiée dans de nombreuses éditions musicales, dont l'approche éditoriale et l'orientation interprétative diffèrent fortement. Les éditions Frühromantiques d'Auer ou de Joachim ont marqué le 19e siècle. Des éditions plus tardives, historiquement informées, ont mis l'accent sur une reproduction aussi originale que possible de la situation des sources. Certaines éditions intègrent des doigtés, des indications de traits et des indications dynamiques, d'autres ne proposent que le texte musical pur. Pour les éditions actuelles, les éditions Urtext reconnues constituent une base indispensable; nonobstant cela, l'histoire de l'adaptation et de l'interprétation avec les prestations historiques d'éminents musiciens constituent des sources de droit en soi, qui influencent inévitablement toute nouvelle étude de la Chaconne de Bach et qui peuvent être mises à profit pour des approches artistiques.
6. Le bon violon pour la chaconne - choix de l'instrument dans le contexte historique et moderne
Quel violon est le mieux adapté à l'interprétation de la Chaconne de Bach ?
Quel violon est le mieux adapté à l'interprétation de la Chaconne de Bach ? Cette question préoccupe aussi bien les interprètes de la pratique d'exécution historiquement informée que les violonistes modernes. A l'époque de Bach, les instruments de la tradition de la famille Amati, de Jakob Stainer et du jeune Stradivari étaient très répandus. Les violons de Stainer jouissaient justement d'une excellente réputation dans les pays germanophones, grâce à leur résonance exceptionnellement élevée par rapport aux instruments historiques et à leur sonorité chaude et sombre.
La différence entre les violons modernes et les violons baroques, comme c'était le cas à l'époque de Bach, est un aspect important et fondamental de la question du violon approprié pour la Chaconne: Avec leur manche plus court, une barre de basse plus légère, des cordes en boyau et d'autres différences de construction, ils offrent une image sonore significativement différente de celle des violons de concert modernes tels qu'ils se sont développés à la suite de Stradivari. Le son plus doux et plus intime des instruments baroques s'est imposé pour de nombreuses interprétations actuelles et semble particulièrement adapté à la structure filigrane de la Chaconne, et pas seulement pour des raisons historiques. Dans l'ensemble, il faut retenir que les violons ayant une caractéristique sonore trop douce ou trop grave sont moins adaptés à la Chaconne de Bach, car ils ne reflètent généralement pas suffisamment le spectre tonal prévu dans la composition.
Interpréter la Chaconne de Bach sur des violons modernes
Mais si les violons baroques sont importants pour des œuvres comme la Chaconne, les enregistrements avec des violons modernes montrent qu'ils permettent aussi d'excellentes interprétations - et pas seulement lorsque la manière de jouer s'inspire des techniques baroques. L'utilisation du vibrato, de la technique d'archet et de l'articulation crée un champ de tension entre l'authenticité historique et l'affirmation sonore. Celui qui joue Bach aujourd'hui est confronté à un choix: essayer de reproduire l'univers sonore d'origine ou avoir pour objectif de faire vivre la musique de Bach avec les moyens du présent. Les deux voies ont leur justification - et toutes deux mènent au cœur de la chaconne.